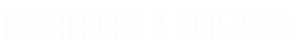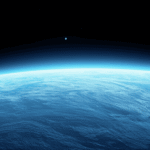À la croisée de la pédagogie, de la psychologie et de la sociologie, une inquiétude grandit dans les établissements scolaires : la montée d’un discours sexiste, viriliste et parfois haineux, alimenté par certaines figures influentes comme Andrew Tate. Selon un sondage mené par le syndicat britannique NASUWT auprès de 5 800 enseignants, 59 % estiment que les réseaux sociaux sont la première cause de dégradation du comportement des élèves, notamment vis-à-vis des femmes.
Un phénomène qui dépasse les frontières britanniques
En France aussi, les témoignages d’enseignants se multiplient. En 2023, une enquête du Haut Conseil à l’Égalité alertait sur une « recrudescence d’attitudes virilistes, humiliantes et hostiles envers les filles », en particulier au collège. Certains professeurs ont rapporté des insultes genrées, des refus de travailler en binôme avec des filles, voire des intimidations inspirées par des figures comme Andrew Tate.
Le phénomène a conduit le ministère de l’Éducation nationale à renforcer les formations à l’égalité filles-garçons dans les rectorats, via les référents académiques à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le dispositif « Égalité filles-garçons à l’école » prévoit également des séances d’analyse critique de contenus numériques dès la classe de 4e.

La masculinité en crise ? Une lecture à nuancer
Il serait tentant de pointer du doigt une génération de garçons influencés par des figures provocatrices. Mais comme le rappellent les chercheurs en psychologie sociale, il faut éviter la stigmatisation globale. Le professeur Pascal Molinier, psychologue du travail à l’Université Sorbonne Paris Nord, explique que « les garçons en construction sont en quête de repères forts. La virilité n’est pas un problème en soi, c’est l’absence de modèle sain de virilité qui crée un vide dangereux. »
De nombreux travaux soulignent que la virilité n’est pas nécessairement toxique. Dans son ouvrage Les hommes, le sexe et l’amour, le sociologue Alain Héril rappelle que « le besoin de puissance, de protection ou d’ancrage dans un groupe fait partie des invariants masculins, tant qu’il n’implique pas la domination ». Le psychologue Michael Reichert, auteur de How to Raise a Boy, affirme que « la masculinité bien guidée favorise l’empathie, la responsabilité, l’engagement communautaire ».
Un combat éducatif, pas idéologique
Les syndicats enseignants comme le SNES-FSU ou le SGEN-CFDT plaident pour une approche pédagogique, fondée sur la discussion, l’analyse et l’exemplarité. Le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) publie chaque année des ressources pour aider les enseignants à décrypter les discours haineux et sexistes en ligne.
Des outils comme Stop Sexisme permettent d’accompagner les jeunes garçons dans la compréhension des codes numériques qu’ils consomment au quotidien. L’objectif n’est pas de brimer, mais d’enseigner un discernement actif.
Redéfinir la virilité pour construire un avenir plus sain
Plutôt que de rejeter en bloc toute expression virile, plusieurs experts recommandent de proposer aux adolescents une virilité positive, fondée sur le courage émotionnel, la responsabilité, l’humilité, l’engagement social et la coopération. La philosophe Olivia Gazalé, dans Le mythe de la virilité, note : « Le problème n’est pas l’homme, mais l’assignation à un modèle de toute-puissance inatteignable. »
En renforçant l’éducation critique aux médias, en écoutant les garçons sans les juger, et en leur offrant des modèles alternatifs, l’école peut devenir un rempart contre les idéologies haineuses. Mais cela suppose un investissement continu des institutions, des familles et des plateformes numériques.