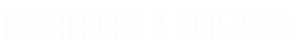Au Maghreb comme dans plusieurs diasporas en Europe, la sorcellerie musulmane — appelée سِحْر (siḥr) — mêle l’invisible et le réel. On y invoque les djinns (جِنّ), entités mentionnées dans le Coran, pour guérir, maudire ou découvrir des trésors enfouis. Cette enquête explore la frontière entre croyance et crime, où se croisent anthropologie, religion et justice.
1. Le cadre doctrinal : le « siḥr » et les djinns dans l’islam
Le mot siḥr désigne en arabe tout acte magique qui altère la perception ou la volonté. Le Coran condamne formellement ces pratiques : « Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d’aucune utilité » (Sourate 2, verset 102).
Selon l’International Institute of Islamic Thought, la sorcellerie islamique traditionnelle repose sur « l’usage d’invocations adressées à des djinns pour influencer le monde matériel ». Les djinns, créatures créées « d’un feu sans fumée » (Coran 55:15), font partie de l’ontologie musulmane depuis le VIIe siècle. Ils peuvent être croyants, mécréants ou neutres, et sont parfois accusés de provoquer maladies, troubles mentaux ou possessions.
Une étude publiée par l’International Journal of Social Psychiatry note que près de 30 % des patients musulmans interrogés croient qu’un djinn peut causer la dépression ou l’anxiété. Le recours au roqya (exorcisme coranique) est alors perçu comme une solution spirituelle légitime.
2. Pratiques populaires au Maghreb : trésors enfouis, enfants « zuhri » et rituels occultes
Dans l’imaginaire populaire marocain et algérien, des trésors cachés sous terre — souvent hérités de l’époque romaine ou ottomane — seraient gardés par des djinns. Pour y accéder, certains croient qu’il faut « offrir » un enfant particulier : le zuhri (الزُّهْرِيّ), censé posséder des marques physiques sacrées : une ligne unique dans la paume, des yeux clairs ou une tache sur la langue.
Selon Morocco World News, certains groupes de « chercheurs de trésors » croient que le sang d’un zouhri « apaise les djinns » qui gardent l’or. Ces croyances, rapportées aussi par Al Arabiya, ont conduit à des enlèvements et parfois des meurtres rituels.
Dans la région de Settat, un homme arrêté en 2022 prétendait pouvoir « ouvrir la terre » à l’aide d’un enfant zouhri. L’affaire, révélée par TelQuel, a révélé un réseau de faux marabouts et de chasseurs de trésor utilisant des textes coraniques détournés, des sacrifices d’animaux, et des formules ésotériques. En arabe, on parle de rukn makhfî (« pilier caché ») : le lieu où sommeille la richesse invisible.
3. Quand la croyance devient crime
Les faits-divers liés à ces pratiques se multiplient. À Fès, en 2019, un couple a été arrêté pour avoir tenté de creuser dans une tombe romaine après un « rêve envoyé par un djinn ». En Algérie, plusieurs enfants zouhris ont disparu dans des zones rurales, poussant des ONG locales à alerter sur « un trafic rituel lié à la sorcellerie traditionnelle ».
Ces affaires révèlent un paradoxe : ce qui est doctrinalement interdit devient, dans certaines couches sociales, un moyen de conjurer la misère. La chasse aux trésors enfouis devient une quête mystique, où se mêlent magie, fatalisme et opportunisme économique. Les autorités, elles, hésitent : comment poursuivre un acte à la frontière du crime et de la croyance ?
4. En Europe : entre exorcisme et vide juridique
La diaspora nord-africaine a importé ces pratiques. En France, en Belgique ou en Suède, la roqya — guérison spirituelle par récitation du Coran — fait l’objet d’une surveillance accrue par la MIVILUDES. Certains exorcistes autoproclamés prétendent « libérer des djinns » moyennant des sommes importantes, voire des rituels dangereux.
Une étude publiée sur SpringerLink analyse la pratique d’un raqi à Stockholm, qui détecte la possession en « plaçant sa paume droite sur le front du patient ». Ce marché spirituel, en forte expansion, échappe encore au cadre juridique européen, oscillant entre thérapie et charlatanisme.
5. Une lecture symbolique et anthropologique
Au-delà du fait religieux, ces croyances traduisent une quête universelle : celle du sens dans un monde où le sacré s’efface. Le trésor enfoui devient une métaphore de la mémoire et du destin : retrouver ce qui a été perdu, réparer une injustice, accéder à la lumière cachée sous la terre. L’enfant zouhri incarne à la fois l’innocence et le sacrifice ; les djinns, eux, symbolisent l’invisible que la modernité refuse mais que les sociétés continuent de craindre.
Comme le souligne l’anthropologue marocain Abdellah Hammoudi, « la sorcellerie est un langage social, une manière de rendre visibles les forces invisibles qui gouvernent nos vies ». Entre mystique, économie et crime, la sorcellerie musulmane demeure l’un des miroirs les plus troublants de nos sociétés.
Sources principales : Morocco World News, ICR Journal, Al Arabiya English, IJSP, Springer Religion & Society.